Dans un monde où la culture est à la fois miroir et arme, exporter une œuvre au-delà de ses frontières ressemble souvent à un numéro d’équilibriste. Entre fidélité à son identité et adaptation aux logiques du marché global, les créateurs doivent choisir : rester enracinés, ou se traduire. La Corée du Sud et le Japon ont su maîtriser cet équilibre, transformant leur culture populaire en force économique. La Chine et la France, elles, cherchent encore leur juste place dans cette géométrie complexe.
Qu’est-ce que le Donghua moderne ?
L’animation chinoise, ou Donghua (动画), occupe un espace fascinant, à la fois local et transnational. Prenons Link Click (时光代理人) : une série saluée à la fois en Chine et au Japon, reconnue pour son rythme précis, son ambiance soignée et sa narration maîtrisée. Sous la surface pourtant, un paradoxe demeure. Son découpage, sa mise en scène et même sa promotion reprennent davantage les codes de l’animation japonaise que ceux du récit chinois traditionnel.

Lorsque Link Click est sorti en version japonaise doublée début 2022, avec les voix célèbres de Toyonaga, Sakurai et Koga, le message était clair : la série ne s’adressait pas seulement au public chinois. Elle s’exprimait dans une langue que les amateurs d’anime du monde entier comprenaient déjà.
Même sa communication suivait les codes du Japon : affiches à la japonaise, bandes-annonces synchronisées avec le calendrier d’animation nippon, mise en avant des seiyuu populaires.

En Chine, le succès fut massif. Le public de Bilibili l’a accueillie avec enthousiasme, et beaucoup y ont vu la preuve que l’animation chinoise pouvait rivaliser avec la japonaise. À l’étranger, en revanche, l’accueil fut discret. En France, les critiques d’Allociné saluent un « animé chinois méconnu » et regrettent qu’il « ne soit pas plus connu ». Donghua a franchi les océans, mais pas encore les barrières culturelles.
Les stratégies d’exportation des studios chinois
Des plateformes comme Bilibili ont décidé d’affronter ce défi de front. Lors de son événement “Anime Made by Bilibili”, la société a dévoilé 68 nouveaux titres pour 2023–2024, dont plusieurs décrits comme des récits « inspirés de l’anime », soutenus par un partenariat avec Fuji TV pour créer B8station, une chaîne japonaise dédiée à l’animation chinoise.
Le message est clair : si le public ne vient pas au Donghua, le Donghua ira à lui.

Aujourd’hui, Bilibili distribue près de 70 séries chinoises sur des plateformes internationales comme Crunchyroll ou Netflix, et sa chaîne YouTube “MADEBYBILIBILI” héberge plus de 135 titres. L’entreprise collabore avec des studios japonais comme Aniplex et des partenaires coréens, formant un véritable réseau transnational.
Mais si la qualité n’est plus en cause, d’où vient alors la résistance ?
Les barrières culturelles à l’exportation
Le véritable obstacle réside dans la traduction, non seulement linguistique mais aussi symbolique. Les œuvres chinoises sont nourries de références historiques et poétiques : mythes wuxia, allusions impériales, jeux d’idiomes (chengyu), et surtout la musicalité propre au mandarin. Pour un spectateur étranger, ces codes peuvent sembler ésotériques, voire décoratifs.

Comme le note un internaute, le wuxia est à la Chine ce que Tolkien est à l’Occident : un univers littéraire immense, rarement traduit. Le mandarin étant une langue à contexte élevé, le passage à l’anglais ou au français demande bien plus qu’une simple conversion de mots.

Les sous-titres constituent eux aussi une barrière. Bong Joon-ho parlait de « la barrière d’un pouce des sous-titres », ce mince obstacle qui sépare des mondes entiers.
Consciente de cette réticence, l’industrie chinoise mise souvent sur les doublages japonais ou anglais plutôt que sur la valorisation du chinois. Résultat : le Donghua circule à travers des voix étrangères, filtré et reconfiguré pour répondre à un imaginaire global déjà codifié.
Clair Obscur : un jeu français pour le monde
Le phénomène inverse s’observe en France.
Clair Obscur: Expedition 33, développé à Montpellier par Sandfall Interactive, a l’apparence d’un JRPG, avec un univers onirique et une direction artistique somptueuse. Pourtant, c’est une œuvre profondément française dans son essence.

Malgré cela, le studio a choisi l’anglais comme langue principale, recruté Charlie Cox et Andy Serkis pour le doublage, et même synchronisé les lèvres sur la version anglaise. Le français, langue de Molière, s’est retrouvé relégué au sous-titrage.
Cette décision a surpris certains joueurs français, mais le pari s’est avéré payant : le jeu s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en trois jours. Le principe est le même que pour Bilibili : adopter la langue de la reconnaissance.

Fierté nationale et langue mondiale
Des blockbusters d’Ubisoft aux films d’animation comme Persepolis ou Tout en haut du monde, les studios français privilégient de plus en plus l’anglais, non par renoncement, mais par pragmatisme.
Cette stratégie ouvre les portes du marché global, mais soulève une question : si chaque œuvre doit parler anglais pour être entendue, que devient sa texture culturelle ?

La comparaison avec la Corée du Sud et le Japon est révélatrice. Ces deux pays ont bâti leur rayonnement sur une confiance linguistique assumée, soutenue par des politiques publiques ambitieuses. Le Hallyu coréen et le Cool Japan japonais ont fait de la culture un levier économique et identitaire, où la traduction sert d’amplificateur plutôt que de filtre.
La réussite coréenne et japonaise
La Corée du Sud, à travers la K-pop et les K-dramas, a transformé sa culture populaire en instrument géopolitique. Comme le souligne la Wesleyan Business Review, BTS et Blackpink attirent “des millions de fans et des milliards de dollars”, tandis que Netflix investit massivement dans ses séries à succès comme Squid Game.
Le Japon, de son côté, soutient ses exportations culturelles par une politique d’État : en 2022, il a enregistré 4,7 milliards de yens d’exportations de contenus, un chiffre comparable à celui de l’acier.
Leur réussite n’a rien d’un hasard : elle repose sur la stratégie, les infrastructures et une maîtrise des langues.
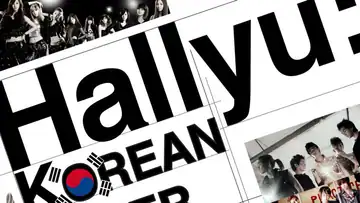
Le paradoxe de la mondialisation culturelle
Au cœur des industries créatives mondiales se cache une contradiction silencieuse : pour exister, il faut parfois se travestir.
La reconnaissance culturelle passe souvent par une auto-traduction esthétique, selon les codes dominants, d’abord occidentaux, aujourd’hui souvent japonais. Ce que l’on appelle “universel” n’est bien souvent qu’un particulier devenu norme.

La mondialisation n’est pas un creuset, mais une galerie de miroirs où se répètent les mêmes formes. Le Donghua, les jeux français, et bien d’autres expressions locales y entrent, leurs contours lissés pour correspondre à ce que le monde attend d’eux.
Peut-être la solution n’est-elle pas d’abandonner la traduction, mais de la redéfinir : créer des passerelles au lieu d’effacer les frontières. En attendant, le paradoxe persiste :
pour être entendu, il faut résonner comme les autres ; pour être vu, il faut s’estomper ; et chaque reconnaissance s’obtient au prix d’un léger oubli de soi.
- yaro
